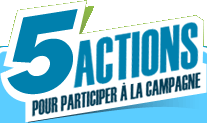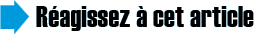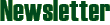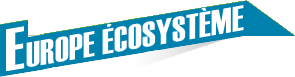Pour une agriculture paysanne et biologique
Les paysans, une espèce en voie de disparition ?
L’agriculture comme tous les autres secteurs de l’économie subit de plein fouet les effets de la mondialisation libérale et l’organisation productiviste de la production. Peu de production agricole se retrouve sur le marché international (10%) cela suffit à déterminer les prix de la plupart des productions qui ne permettent pas d’assurer un revenu aux paysans ici et ailleurs. Les aides européennes à l’ha sans plafonnement favorisent les plus grosses exploitations, l’agrandissement et les cultures les plus facilement mécanisables.
La préférence communautaire qui a permis la « prospérité » agricole de quelques grands pays européens comme la France n’existe pratiquement plus sous la pression de l’OMC et du libéralisme dominant. Le dernier exemple : le lait dont la dérégulation de la production (fin des quota) provoque la chute des cours et la fuite en avant dans l’agrandissement et l’intensification.
Peu de secteurs de l’économie impactent autant d’aspects de la vie humaine et de la planète : l’alimentation, l’eau, la biodiversité, les paysages, l’énergie, la vie des territoires. L’agriculture est donc au cœur de la « révolution » écologique que nous devons accomplir et elle illustre parfaitement le lien systémique entre les ravages environnementaux et les conditions de vie des ses travailleurs.
Les scandales alimentaires successifs de notre décennie participent à la prise de conscience écologique d’aujourd’hui et ce n’est pas pour rien que dans les domaines de la production agricole et de l’alimentation, des expériences au caractère écologique et social exemplaires se développent.
Les régions ont un rôle important à jouer et l’Aquitaine en particulier. La population agricole de notre région est au dessus de la moyenne nationale. Nous avons encore une certaine diversité de production. Mais la situation se dégrade vite (le maïs représente ¼ de la surface agricole utile). On ne peut plus se contenter de saupoudrage financier sans objectifs clairs de conversion écologique du secteur.
Les paysans ont tout à gagner à prendre le train de l’écologie, faut-il leur démontrer le bond qualitatif que cela représente pour leur vie et leur métier, et l’ensemble de la société.
Agriculture biologique, agriculture écologique, agriculture paysanne
Une équation complexe : comment l’agriculture peut-elle à la fois mettre en oeuvre des techniques qui préservent la nature, le paysage, la qualité gustative et sanitaire de ses produits, un coût raisonnable de l’alimentation et la rémunération équitable des paysans ?
L’agriculture bio parce qu’elle s’interdit toute utilisation de pesticides, qu’elle pratique l’assolement, et la diversité en matière de semences et de races animales constitue le pilier de la transformation écologique de l’agriculture. Mais il faut savoir que l’Agriculture biologique est régie par un cahier des charges européen qui subit de temps en temps des toilettages qui ne vont pas obligatoirement dans le sens de plus de rigueur écologique (cf les mesures appliquées depuis le 1er janvier 2009).
La demande croissante des consommateurs ouvre le marché des produits bio et certaines règles de production et de transformation sont « gênantes » pour quelques opérateurs qui ont le « chiffre » pour priorité, quand ce n’est pas la seule.
D’autre part sur un certain nombre d’aspects importants du point de vue de l’écologie, le cahier des charge de l’Agriculture biologique soit ne dit rien , soit n’a pas de caractère obligatoire : dimension des fermes, énergie utilisée, irrigation, biodiversité...
Les aspect sociaux ne font pas partie également des prescriptions du cahier des charges. Le caractère équitable de la filière bio est le fait de certains acteurs , mais pour l’essentiel des opérateurs on est loin du compte.
Notre projet d’agriculture ne peut donc se ramener à la généralisation de l’Agriculture biologique telle que exactement définie et majoritairement pratiquée aujourd’hui. Nous devons y superposer un projet d’agriculture paysanne qui lui, prend en compte les aspects sociaux, vie des territoires, pratiques écologiques.
Un revenu équitable pour les paysans : condition nécessaire de la conversion écologique de l’agriculture
La pratique agricole définie comme productrice d’aliments, accessoirement d’énergie, protectrice de la nature et entretien du territoire constitue un métier exigent, nécessitant beaucoup de compétences et aux objectifs parfois contradictoires. A savoir que le respect de la biodiversité, l’absence de produits de synthèse, par exemple, peut rendre plus aléatoire les rendements de la ferme. L’entretien de haies, bosquets ou autres éléments du paysage sont le plus souvent une charge de travail qui n’est pas rémunérée par la vente des produits.
Le prix des matières premières agricole est maintenant soumis aux fluctuations du marché international . Ces éléments d’insécurité du revenu des paysans sont des obstacles majeurs à des pratiques écologiques conséquentes et de nature à justifier certaines aides directes.
Au niveau régional, nous n’aurons pas grande influence sur la libéralisation des marchés, par contre à travers un concept de souveraineté alimentaire des territoires et re localisation de l’économie nous devons intégrer la notion de prix et rémunération équitables pour tous les acteurs de la filière. Concrètement cela peut passer par des conventions et un soutien de différentes initiatives en matière de vente de proximité intégrant cet aspect.
Il existe déjà un certain nombre d’initiatives(dans lesquelles nous sommes souvent présents) sur lesquelles il faut s’appuyer pour mettre en place un véritable plan régional qui intègre tous les aspects d’une agriculture écologique et paysanne, y compris la question des prix.
L’agriculture péri urbaine : Fer de lance d’une alimentation de proximité et d’emploi agricole.
Le succès des AMAP et autres formules de ventes directes se manifeste particulièrement dans les agglomérations, au point qu’il faut aller de plus en plus loin chercher des producteurs pour répondre à la demande. Les ceintures maraîchères n’existent plus, détruites par l’urbanisation galopante et la généralisation de la vigne autour des grandes villes comme Bordeaux.
Quelques expériences existent afin de mobiliser du foncier autour de villes ou agglomérations, soit initiatives de collectivités, soit associatives (CATA, Terres de lien, GFA Pays basque) Il faut non seulement soutenir ces initiatives mais les développer, préciser le statut du producteur (éviter le rachat du foncier) et lui demander un engagement sur le mode de production et de vente de proximité dans le cadre d’une démarche collective.
De façon plus générale le soutien aux petites fermes et les productions vivrières seront privilégiés. Les soutiens ne devront plus aller aux concentrations terriennes, aux cultures et élevages hors sol, à la production d’agro-carburant industriels(éthanol, diester), mais la filière huiles végétales pures sera privilégiée.
Le secteur agroalimentaire ne doit pas échapper à la logique écologique.
L’approvisionnement sur le territoire, les conditions imposées aux producteurs, les procédés de fabrication, le recyclage des déchets, la vente en région seront des pistes à approfondir en terme d’expériences à vulgariser et de critères de financement. Les entreprises les plus importantes de l’agroalimentaire sont souvent à statut coopératif, tout en ayant oublié ce que cela impliquait vis à vis des producteurs et n’ayant jamais envisagé d’en étendre le principe aux salariés.
La question des signes de qualité
L’Aquitaine serait la première région française pour le nombre de productions labellisées. Le vin tient une place très importante : 1ère région pour la superficie plantée en AOC. Un vrai débat doit être mené sur le contenu de nombreux labels, y compris en vins AOC. L’évolution récente ayant tendance à privilégier la quantité sur les critères de qualité.
La viticulture subit également de plein fouet un crise sans précédent. Les petits viticulteurs doivent être soutenus et accompagnés dans une démarche de qualité et de la commercialisation de leur production.
L’agriculture secteur stratégique majeur devra bénéficier d’un financement renforcé et du redéploiement des financements existants afin de favoriser la souveraineté alimentaire du territoire, l’installation, l’autonomie, la vente de proximité, la biodiversité, le paysage, la qualité de l’eau, le recyclage, l’agriculture biologique et la formation.
NOS PROPOSITIONS POUR LA RECONVERSION ECOLOGIQUE DE L'AGRICULTURE
1. Favoriser l’installation de nombreux paysans et acquérir du foncier
Nous devons faciliter l'accès au foncier et la transmission des petites fermes plutôt que d'agrandir continuellement des exploitations déjà grandes car il faut reconstituer à la périphérie des villes des ceintures de polyculture-élevage afin d'assurer une alimentation de qualité et de proximité. Il s’agit donc de s’assurer de la maîtrise foncière de terrains susceptibles d’être maintenus ou restaurés en zones agricoles.
La Région en liaison avec les agglomérations , communautés de Communes et SAFER mettra en place des EPFL (établissement public foncier local) afin d’acquérir du foncier pour le mettre à disposition de jeunes agriculteurs.
2. Assurer l’autonomie alimentaire des territoires et de l’Aquitaine
L’autonomie alimentaire est un principe fondamental qui doit se décliner au territoire régional. Il aura pour conséquence la réduction des flux export-import et ouvre un potentiel d’installation de fermes orientées sur les cultures vivrières, en particulier à proximité des villes et agglomérations.
3. Assurer la création de circuits courts
Ces installations se feront dans le cadre de conventions tripartites (collectivités/agriculteurs/associations d’AMAP et de consommateurs) précisant les modes de production écologique et de distribution en circuit court, prix, ainsi que des formations spécifiques.
Le rapport direct producteur consommateur est un gage de qualité , de lien social et de réduction des gaz à effet de serre. L' industrie agro-alimentaire doit prendre en compte ces exigences dans ses approvisionnements, ses processus de production et ses ventes en favorisant les produits de saison et des prix équitables.
4. Assurer l’autonomie protéique des élevages
Aujourd’hui l’alimentation protéique des élevages de notre région se fait essentiellement avec du soja importé, le plus souvent transgénique, qui participe à la déforestation et au recul des cultures vivrières en particulier en Amérique latine. L’encouragement à la production, ici, de cultures riches en protéine (soja, féveroles, lupin, luzerne etc...) doit être inscrit au budget de la région bien que devant relever des primes européen le cadre de la réforme de la PAC pour 2013. Outre une plus grande autonomie alimentaire des élevages, la pratique des cultures protéiques permettront d’améliorer la rotation des cultures et le recul du maïs en monoculture.
5. Assurer l’autonomie énergétique des fermes
L’autonomie énergétique par la production d’HVP utilisée prioritairement pour la motorisation agricole à partir de tournesol est à favoriser dans la limite de 25% de la sole grande culture, ainsi que le recours à la méthanisation et au photovoltaïque.
6. Assurer la biodiversité cultivée avec les semences paysannes
Le territoire régional en concertation avec les Conseils généraux sera déclaré interdit d’OGM. La diffusion de semences reproductibles à la ferme sera encouragée. La recherche et l’expérimentation de variétés population rustiques et adaptées à nos terroirs sera confortée. Il existe actuellement plusieurs stations d’expérimentation , reproduction et vente de ces variétés en Aquitaine.
7. Assurer la production de biomasse pour la fabrication d’éco-matériaux
La monoculture intensive du maïs n’est plus viable ni économiquement, ni écologiquement. Il faut diversifier les cultures. Une aide spécifique à l’ha sera accordée pour la conversion à la cultures de plantes comme le chanvre, le lin…
8. Tendre vers le zéro pesticides et réformer le dispositif AREA
Sur le plan de la qualité des eaux, la réduction des pesticides est un objectif prioritaire. Les mesures du dispositif AREA (agriculture respectueuse de l’environnement en Aquitaine) du Conseil régional) devront être redéfinies profondément.
9. Redéfinir les aides à l’irrigation et anticiper les effets du changement climatique
Les aides à l’irrigation et au stockage de l’eau feront l’objet d’une redéfinition en profondeur. Les rotations de cultures, l’abandon de la monoculture du maïs, les modes de travail du sol et de fertilisation, l’utilisation de semences résistantes à la sécheresse sont des préalables à l’intervention de l’irrigation qui devra être pratiquée prioritairement sur les cultures vivrières avec des plafonds de surface par exploitations.
10. Recycler la matière organique pour fournir un compost de qualité aux agriculteurs
La réduction des engrais de synthèse dont le bilan carbone est très mauvais peut être avantageusement compensé par le recyclage de proximité de tous les déchets végétaux des particuliers et collectivités. C’est au stade des communautés de communes qu’il faut organiser la fabrication de compost à destination de l’agriculture locale. La région interviendra en soutien. L’entretien des haies, bois et autre élément du paysage peut être une source de matière compostable ou BRF et créateur d’emploi.
11. Passer de 2% à 20 % de surfaces cultivées en bio en Aquitaine
De par son cahier des charges l’Agriculture biologique s’inscrit largement dans les mesures décrites plus haut. Il conviendra d’appuyer fortement son développement dans un contexte d’augmentation de la demande en produits bio et un déficit persistant de production locale et nationale.
D’autre part le marasme dans les productions conventionnelles (- 35 % de revenu en moyenne nationale,- 20% en Aquitaine) devrait favoriser la conversion en bio. A cet effet, la prise en charge des frais de certification des opérateurs par la Région sera maintenue, ainsi que l’aide à l’acquisition de matériel spécifique.
Le soutien et l’accompagnement des agriculteurs dans la conversion et l’approfondissement des pratiques de l’Agriculture biologique fera l’objet d’un plan régional associant les structures de développement sur le terrain, avec des aides financières substantielles à l’ha. La formation en Agriculture biologique fera l’objet d’une évaluation afin d’en mesurer son adéquation aux besoins et aux objectifs de développement qualitatif et quantitatif.
12. Soutenir et redynamiser la coopération, de la production à la commercialisation
L'agriculture a une longue tradition de coopération qu’il s’agit de conforter.
13. Soutenir le retour aux fondamentaux d'une viticulture de qualité, expression authentique de nos terroirs afin qu’elle échappe à la crise actuelle.