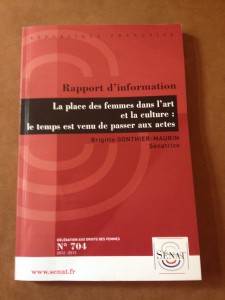Quelle place pour les femmes dans l’Art et la Culture ?
Intervention de Corinne Bouchoux lors du débat sur la place des femmes dans l’art et la culture suite au rapport d’information « La place des femmes dans l’art et la culture : le temps est venu des passer aux actes » de Brigitte Gonthier-Maurin.
Le lien du rapport : http://www.senat.fr/notice-rapport/2012/r12-704-notice.html
Monsieur le président,
Madame la ministre,
Madame la rapporteur,
Mes chers collègues,
La place des femmes dans l’art et la culture n’est pas dissociable de celle des femmes et des hommes dans la société.
Rappelons que l’an dernier, dans cette enceinte même, l’un de nos collègues, un peu énervé par un débat, disait de l’une de nos collègues, vice-présidente d’une commission : « Qui c’est cette nana ? »
Rappelons que voilà encore quelques jours, un député UMP a pu « caqueter » alors que notre collègue Véronique Massonneau s’exprimait sur la réforme des retraites : nous nous réjouissons que ce dernier dérapage ait été sanctionné rapidement par une ponction significative sur l’indemnité parlementaire du fautif.
Je ne résiste pas non plus au plaisir de signaler les propos tenus par l’un de nos augustes collègues lorsqu’il est en difficulté avec une femme : « Je vais appeler son président, ou son mari » !
Sous couvert d’un paternalisme plus ou moins assumé, sous couvert de culture méridionale ou nordiste, sous couvert aussi du « noviciat », très relatif des femmes, le sexisme a encore la vie dure et il ne faut rien laisser passer, ni dans cet hémicycle ni au dehors.
On pourrait imaginer que la situation soit plus favorable dans le monde de l’art ou de la culture. L’exception créatrice et le génie de l’invention seraient-ils mieux protégés du sexisme et du préjugé que le reste du monde ? Rien n’est moins sûr et notre rapporteur l’a démontré ce soir avec talent : dans le monde de la culture et de l’art aussi, le sexisme est au rendez-vous !
Les excellents travaux de Reine Prat et le rapport de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes montrent que la situation est même parfois pire dans le domaine de l’art. Les chiffres de 2006 – hélas, trois fois hélas ! – n’ont pas évolué, les exclusions sont inchangées et les femmes restent absentes des postes stratégiques, même si elles sont les plus pratiquantes en matière d’art et de culture. Nous nous réjouissons, bien sûr, que le ministre de la culture et de la communication soit une femme, très féministe à ce que nous avons compris. C’est bien, mais c’est loin d’être suffisant !
De nos jours, les publics de toutes les écoles sont mixtes, les pratiques artistiques se sont diffusées, même si des inégalités sociales demeurent, ce que je déplore, les voies d’accès aux métiers et carrières artistiques sont toutes féminisées – dans certaines écoles, les femmes sont plus nombreuses que les hommes –, mais le pouvoir reste désespérément masculin, un peu comme dans le monde de l’école, où l’on ne trouve que des femmes à l’école maternelle, alors que, dans l’enseignement supérieur, la quasi-totalité des professeurs sont des hommes. Il en va de même dans le domaine de l’art et de la culture.
Face à ce constat, nous ne pouvons que souscrire au diagnostic établi dans le rapport de la délégation et affirmer, de nouveau, qu’il faut lutter contre les stéréotypes véhiculés dans nombre de contenus culturels, dont les jeux vidéo – nous partageons votre analyse sur ce point, madame la présidente ! –, et ce n’est pas simple, car la liberté de créer et la lutte contre le sexisme tendent parfois à s’opposer.
Par ailleurs, il faut lutter ardemment contre l’invisibilité des créatrices : leur éviction très fréquente d’un certain nombre de manifestations culturelles et leur sous-représentation sont encore des problèmes majeurs. Il faut donc mener une politique volontariste et encourager des productions féminines ou fortement féminisées.
Enfin, la question a déjà été évoquée et Mme la ministre s’attèle à son règlement, la « surmasculinité » critique des postes de direction dans les institutions et industries culturelles et dans la presse est un problème général qu’il convient de prendre à bras-le-corps, également pour aider notre démocratie !
Le vivier existe : les femmes ont acquis des formations, des diplômes, elles ont du talent, tout le monde en convient. Pourtant, lorsqu’il s’agit d’accéder aux postes de responsabilité, rien ne va plus ! « Vais-je être capable ? Vais-je réussir à concilier tout ? En ai-je vraiment envie ? » : ces questions que toute femme se pose en s’engageant dans la vie associative, culturelle ou artistique, quel homme se les pose vraiment ? Cette sorte d’hypermodestie, cette vogue du doute permanent, ce questionnement sur le sens de la prise de responsabilité ne semblent pas étouffer outre mesure la plupart de nos amis de sexe masculin. C’est un comportement socialement construit, qui ne doit rien au biologique ; c’est une forme de domination, involontaire ou volontaire, qu’un certain nombre d’hommes exercent dans la société, y compris dans le monde artistique et culturel.
Sans aller jusqu’à citer Gramsci – mais nous sommes en petit comité ! –, vous le savez comme moi, la culture joue un rôle majeur dans la prise de conscience des inégalités de toute sorte dans la société.
Il est temps de redonner aux femmes leur juste place dans l’art et la culture. Les trois vagues du féminisme en France ont bien sûr joué un rôle clé dans cette évolution : mieux les connaître permettrait peut-être d’aider à briser un certain nombre de préjugés.
À l’heure de la mixité de l’école maternelle jusqu’à la maison de retraite, il est temps d’encourager les femmes créatrices. Les récentes réformes de la loi sur l’école vont dans le bon sens, Mme le rapporteur l’a signalé.
Il faut promouvoir coûte que coûte des mesures qui, justement, ne coûtent rien : pour reprendre un exemple qui me tient à cœur, il serait si simple de donner à des rues ou à des places des noms d’artistes femmes – cela a été fait à Angers et je tiens à le saluer. Il faut également soutenir les propositions de Philippe Belaval qui visent à ne plus admettre que des femmes au Panthéon pendant l’actuel quinquennat, en particulier des résistantes, comme Germaine Tillion et Lucie Aubrac – elles furent des femmes de culture, l’une étant ethnologue et l’autre enseignante –, mais aussi des artistes. Par ailleurs, ces cérémonies doivent être des temps de partage démocratique et non pas des grands-messes laïques réservées à quelques happy few des quartiers mondains !
De plus, il faut placer au premier plan les arts visuels et le soutien aux photographes. La photographie est un art particulièrement accessible et démocratique et le métier s’est révolutionné : il faut également accorder une meilleure place aux femmes photographes.
En outre, les organisateurs de manifestations culturelles doivent être encouragés, au besoin par des mesures pécuniaires, à assurer une meilleure parité dans le choix des pièces artistiques présentées, tout comme il serait souhaitable que les conservateurs de musée ne se penchent pas uniquement le 8 mars sur les aspects féminins de leurs collections ou lors d’un grand événement, même s’il est très réussi : la culture doit se vivre tous les jours, et l’art mixte aussi !
Enfin, si l’on peut se féliciter de l’organisation de nouvelles expositions portant un regard iconoclaste, comme l’actuelle exposition sur le nu masculin au musée d’Orsay, il serait hautement urgent d’examiner ce qui se passe dans les FRAC en matière d’acquisitions et d’exposition des œuvres acquises : on achète des œuvres de femmes, mais elles sont trois fois plus nombreuses dans les remises que les œuvres d’hommes. Allez m’expliquer pourquoi ! Si les collections d’antan – jadis, il y a très longtemps – relevaient d’une époque où les femmes étaient très peu présentes et se trouvaient dans la situation de mineures reléguées aux tâches domestiques, aujourd’hui toutes nos collections sont mixtes : il faut donc que nos expositions le soient également !
Madame la rapporteur, madame la ministre, c’est en ayant chaussé ces « lunettes de l’égalité » que nous aborderons avec détermination l’examen du rapport pour avis consacré au budget des arts visuels.
Il me reste quelques secondes que je voudrais utiliser à citer certains noms qui n’ont jamais dû être entendus dans cet hémicycle : Louise Abbema, Chantal Akerman, Laure Albin Guillot, Geneviève Asse, Barbara, Anna-Eva Bergman, Sarah Bernhardt, Rosa Bonheur, Louise Bourgeois, Jeanne Bucher, Marcelle Cahn, Claude Cahun, Sophie Calle, Hélène Cixous, Germaine Dulac, Françoise d’Eaubonne, Alice Guy, Juliette, Marie Laurencin, Julie Manet, Annette Messager, Berthe Morisot, Musidora, Orlan, Rachilde, Carole Roussopoulos, nous avons besoin de vous !