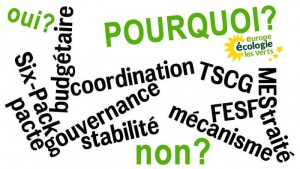« Petit argumentaire pour remettre le TSCG à sa place » par Y. Jadot, E. Gaudot & R. Garoby
Petit argumentaire pour remettre le TSCG à sa place – 7 septembre 2012
Yannick Jadot – député européen EELV
Edouard Gaudot – Délégué Thématique « Europe fédérale » au COP
Roccu Garoby – Conseiller politique sur le Budget du Groupe Verts-ALE au PE
« Pour résumer ma pensée, je vous dirai que le but serait alors de réduire la souveraineté aux limites de l’indépendance, et, par conséquent, de transférer à la communauté internationale ou européenne toutes les portions de souveraineté qui excèdent l’indépendance. » Léon Blum – avril 1948
1. Un texte redondant au regard de ce qui existe déjà
a. ce traité reprend l’essentiel de la législation européenne déjà (amendée) et votée par le Parlement Européen dite « 6 pack » et (bientôt) « 2 pack »…(Règlement relatif au renforcement de la surveillance économique et budgétaire des États membres (COM(2011)0819) et règlement établissant des dispositions communes pour le suivi et l’évaluation des projets de plans budgétaires (COM(2011)0821)). Que le TSCG soit ou non ratifié par la France, beaucoup de ses éléments les plus critiqués sont donc déjà en vigueur et le resteront. Il y ajoute même quelques éléments positifs, sur la méthode communautaire, l’implication du PE et des parlements nationaux, l’inclusion des pays non membres de la zone euro etc.
b. Le contexte ne va pas changer non plus: pendant des années, les dirigeants européens ont accepté, et même accompagné, les transferts de souveraineté économique vers les marchés et la finance, surjouant l’illusion de leur souveraineté nationale. Depuis le début de la crise, ils tentent de passer entre les gouttes et d’éviter les réformes structurelles. Les yeux rivés sur les sondages, Angela Merkel a géré les plans de sauvetage à la Grèce en fonction des élections régionales. Résultat : la crise grecque menace la zone euro et Merkel a perdu toutes les élections. Mal fagotés, hypocritement déguisés, trop peu trop tard, des prêts ont néanmoins été accordés, principalement financés par l’Allemagne. En échange de cette solidarité, l’Allemagne a exigé la discipline, celle que ni l’Allemagne ni la France n’avaient respectée pendant des années. MES contre TSCG, c’est le compromis européen depuis 2011. Mais l’austérité portée par l’Allemagne et validée par Sarkozy a rajouté de la récession à la récession.
c. En gros ce texte est surtout une déclaration de politique générale des gouvernements européens qui l’ont signé et ratifié, qui dit : « 1. nous allons rétablir l’équilibre de nos finances publiques et 2. nous allons travailler à ce que nos politiques économiques convergent ».
La valeur ajoutée économique de ce texte est donc faible voire nulle; parce que sa valeur ajoutée est principalement politique.
2. S’opposer à quoi ? peuple contre peuple ?
a. le TSCG a été négocié sous cette forme de compromis principalement pour pacifier les opinions publiques des principaux pays contributeurs de la zone euro – Allemagne, Autriche, Pays-Bas et Finlande. Ces « peuples » ne sont pas moins légitimes dans leurs craintes (réelles ou fantasmées) et leurs préjugés (idiots ou justifiés) que les « peuples » qui considèrent que l’austérité est injuste et illégitime. L’incapacité de réformes structurelles d’un Etat grec corrompu et son évasion fiscale généralisée ne sont pas des inventions de Merkel, ni l’explosion de l’endettement privé espagnol pour financer des villes entières de béton armé aujourd’hui vides ; la concurrence fiscale déloyale en Irlande, la déflation compétitive en Allemagne et les baisses de l’impôt des ménages et des entreprises les plus favorisées depuis 2000 en France ne sont pas non plus des fantasmes – alors qui a raison?
b. Personne ne peut se prétendre plus vertueux : de nombreuses erreurs collectives ont été commises: mensonge sur les comptes publics, aveuglement coupable des institutions européennes et complicité plus ou moins active des gouvernements au pouvoir lors de la création de la zone euro et de l’inclusion de la Grèce… A l’époque en France : gouvernement Jospin à majorité plurielle, en Allemagne, gouvernement Schröder Rouge-Vert… alors attention aux lectures gauche/droite qui peuvent faire boomerang.
3. Le mythe de l’autonomie budgétaire nationale
a. la monnaie commune a ôté aux gouvernements français leur instrument préféré : la politique monétaire et la pratique régulière de la dévaluation compétitive (perte d’un tiers de la valeur du Franc sur la période 1979-1989 ; dévaluations en séries de 81, 82, 83…) qui permet de préserver la compétitivité aux dépens de la monnaie plutôt que de s’attaquer aux réformes structurelles (quelles qu’elles soient). C’est pourquoi ils ont surcompensé en abusant de la politique budgétaire – qui permet de la même façon de préserver la compétitivité aux dépens de l’équilibre des finances…
b. nous payons aujourd’hui la facture de l’échec spectaculaire de la stratégie de Lisbonne. Ce texte négocié de haute lutte en 2001 sous présidence portugaise (Barroso) devait « faire de l’Europe l’économie la plus compétitive en 2010″… il s’agissait évidemment de tracer les grandes lignes de convergence des politiques économiques des Etats membres pour faire en sorte d’avoir une politique économique de la zone euro (voire de l’UE) plutôt que 27 (15 à l’époque) politiques économiques nationales… seulement voilà, Français, Allemands en tête, tous les grands Etats ont refusé d’avoir des objectifs communs contraignants sous la supervision de la commission. A la place on a mis en place la « Méthode Ouverte de Coordination » autrement dit « chacun fait sa soupe chez soi, et la commission n’a qu’à regarder si ça la chante, on s’en tape… » d’où l’épisode où Chirac et Schröder se sont ensemble assis sur les critères de Maastricht en 2003, en violation des traités…
C’est cette addition qui se paye au prix fort avec la « crise des spreads » (écart entre les taux d’emprunt des pays de la zone euro) : personne n’a surveillé l’endettement privé espagnol et irlandais complètement délirant (dû au crédit facile que procurait le confort de la zone euro) ni l’endettement public grec et portugais – a fortiori pas celui de Berlusconi; de même, personne ne s’est inquiété des effets de la politique de désinflation compétitive allemande menée depuis 2004.
4. La « transformation écologique de la société » a-t-elle besoin d’un déficit budgétaire pour se financer ?
a. au niveau national, probablement pas : la réallocation des ressources, par exemple du nucléaire vers les renouvelables ou de la défense vers l’éducation laisse de réelles marges de manœuvre. En outre, la fiscalité écologique et la redistribution sociale sont des leviers essentiels dans ce processus.
Nous payons aussi la facture d’un modèle de développement à crédit à la recherche d’une hypothétique croissance toujours selon les vieilles recettes d’augmentation des dépenses (gauche productiviste) ou de réduction des impôts donc des recettes (droite libérale).
b. au niveau européen, oui et non : il faut des ressources pour la transition vers d’autres structures, mais il y a 2 moyens d’augmenter celles-ci au niveau européen:
-
sous la forme des ressources propres du budget de l’UE, grâce à la Taxe sur les Transactions Financières, et/ou avec une taxe carbone interne et externe: interne pour contribuer à transférer progressivement la fiscalité sur le travail à une fiscalité sur les pollutions et externe pour pousser nos partenaires commerciaux à élever leurs ambitions de politique climatique.
-
sous la forme du « grand emprunt » qu’Europe Ecologie a proposé à l’occasion des élections européennes de 2009. Pour contourner l’impossibilité pour la BCE de contracter ce grand emprunt elle-même, l’idée est de faire émettre un emprunt en euro donc forcémentau même taux, par les banques centrales des Etats membres, sous la coordination de la BCE, garante du remboursement de l’emprunt. Les 1000 milliards doivent être affectés aux besoins réels des économies européennes les plus en difficultémais en même temps servir à financer la transformation de notre système de production et au premier rang de ses employés, avec un mécanisme d’accompagnement.
Pour lever de telles sommes en solidarité européenne, il faut s’assurer que les Etats membres et les institutions européennes ont la crédibilité nécessaire sur les marchés où se contracte l’emprunt. Donc des finances publiques fiables et assainies.
Il s’agit ni plus ni moins que de reprendre la main sur les marchés, à travers:
-
l’union bancaire, avec la mutualisation des systèmes de garanties de dépôts, la mise en place d’un fonds de résolution des crises bancaires et la supervision directe des banques par la BCE
-
et une plus forte mutualisation des dettes nationales qui constitue à l’évidence un élément puissant d’intégration limitant la vulnérabilité et l’isolement des Etats face aux attaques des marchés.
5. Sortir du piège d’un débat hexagonal
a. parmi les objectifs politiciens de ce traité, Sarkozy et Merkel savaient pertinemment qu’ils mettraient en difficulté leur opposition de gauche divisée sur la question européenne et sur la question de la dette. Le coup a magnifiquement réussi. Le piège du débat national est parfaitement illustré par les arguments de la renégociation; le sort du TCE l’a montré clairement: on ne renégocie pas un compromis européen. Le traité de Lisbonne a repris (en pire, puisqu’affaiblies pour les bonnes et renforcées pour les mauvaises) la plupart des dispositions qui avaient mené au rejet du TCE. Il n’y a pas de « non fédéraliste » dans les questions européennes. C’est une illusion. Il n’y a que des compromis, toujours insatisfaisants.
La seule chose sensée exigible en revanche, c’est de même que le Bundestag l’a imposé à Merkel, imposer au gouvernement français l’obligation de soumettre au Parlement ses mandats de négociation au Conseil. Donc de sortir du présidentialisme – et à terme de l’intergouvernemental au niveau européen.
b. L’arrivée au pouvoir de François Hollande a modifié la donne européenne et déverrouillé la stratégie Merkozy. Au couple discipline-solidarité, il a ouvert un espace sur la relance : pas de sortie de crise sans investissement. L’austérité ajoute de la récession à la récession. Même opposé à la logique de l’endettement, on peut être très favorable aux investissements qui préparent l’avenir et réparent le passé. Le pacte de croissance, que nous préférons appeler Pacte d’investissement, est un premier pas possible dans la transformation de l’économie européenne. Il faut peser pour que le plan de relance européen comprenne, entre autres :
-
La rénovation thermique des bâtiments, en particulier les logements des dizaines de millions d’Européens souffrant de précarité énergétique.
-
La protection vis-à-vis des importations chinoises et la définition d’une politique industrielle commune de développement des énergies renouvelables (recherche et innovation, soutien à la mise en place de 3 à 4 sites européens de production de cellules photovoltaïques, appui à la mise en réseau des PME et ETI de production de panneaux…)
-
la création d’un « EADS » du tramway, accompagné d’un programme européen de développement de la mobilité douce.
c. la dynamique institutionnelle européenne initiée par ce texte est plutôt bonne car elle fait enfin de la Commission européenne un réel lieu de convergence des politiques économiques des Etats membres. Donc c’est une européanisation des débats budgétaires. Désormais il n’est plus possible de faire n’importe quoi sans se justifier auprès de ses partenaires. L’indépendance, oui, la souveraineté, non. On obtient donc un canal pour critiquer légitimement et directement les insuffisances grecques, mais aussi la politique de désinflation compétitive allemande.
d. vers une vraie intégration politique européenne. Les pouvoirs accrus de la Commission européenne exigent donc maintenant de renforcer:
-
le budget européen qui doit devenir supranational, abondé en ressources propres et augmenté substantiellement pour devenir un vrai instrument de redistribution et levier d’investissement : le budget américain n’a commencé sa fédéralisation qu’en 1932, avec Roosevelt, afin de lutter contre la crise. Aujourd’hui il dépasse les 20% du PIB US, mais cela s’est fait de manière très progressive. En 1932, il n’était que de 1% (comme l’actuel budget UE), et en 1945, de 7%.
-
le contrôle démocratique de la Commission en devient encore plus crucial. Intergouvernemental, le TSCG renforce les pouvoirs de contrôle de l’UE sur les Etats membres or seule une instance politique, au sens démocratique du terme, peut être renforcée afin de contrôler au mieux les politiques budgétaires et économique des Etats. Il ne peut se concevoir que dans un processus politique qui doit avoir pour but final la construction d’une Europe politique.
Se faire plaisir? ou faire de la politique?
Il existe de bonnes raisons de soutenir le TSCG, mais il y a aussi de bonnes raisons de ne pas s’opposer à un texte qu’on n’aime pas… au moins par l’abstention.
-
Sortir du débat hexagonal et des postures tactiques est une preuve de maturité politique et d’engagement européen.
-
Les objectifs clairement stipulés d’équilibre budgétaire sont restrictifs et insuffisants – ce qui en fait un texte bancal, sans prise en compte honnête de la réalité des politiques budgétaires en temps de crise où un peu de déficit permet d’amortir la conjoncture. Mais son rejet ne changera rien aux politiques mises en place. Quel que soit tout le mal qu’on puisse légitimement penser des politiques d’austérité menées aujourd’hui en Grèce, Espagne et ailleurs, ce n’est pas ce texte qui les a initiées et son rejet n’empêchera en rien qu’elles soient poursuivies. Les choix faits par les gouvernements de couper dans l’éducation, la santé ou la protection sociale ne dépendent pas de l’adoption du TSCG. Par exemple, Rajoy a été élu sur ce programme antisocial et horrifiant par les Espagnols eux-mêmes.
-
la sortie de crise en solidarité européenne ne peut passer que par la mutualisation des dettes (MES) et la supranationalité budgétaire (TSCG). Il faut l’une pour l’autre… Nous voulons la mutualisation des dettes ? Nous n’échapperons pas au contrôle des dépenses publiques par les bailleurs de fonds. Simple bon sens.
Et cela va coûter à tout le monde :
« Pour sauver l’euro et le projet sans égal sur le plan historique d’une Europe unie, les deux Etats les plus puissants doivent mettre en jeu leur bien le plus précieux : l’argent pour l’Allemagne et la souveraineté pour la France. » Stefan Ulrich, édito de la Süddeutsche Zeitung, 6 juin 2012 (journal de gauche).
La valeur ajoutée politique du TSCG est entièrement dans la dynamique européenne qu’il peut permettre d’ouvrir.
C’est à nous de faire en sorte qu’il ne soit pas un coup dans l’eau:
-
en demandant l’application de la clause d’assouplissement pour conditions exceptionnelles pour montrer qu’un texte n’est pas une mécanique aveugle;
-
en exigeant de notre majorité un engagement fort au Conseil européen sur un budget européen renforcé, abondé par des ressources propres réelles;
-
en engageant le Parlement français aux côtés des autres parlements nationaux et du Parlement européen pour exercer un réel contrôle démocratique des pouvoirs budgétaires attribués à la Commission européenne.