Entendre ce que dit et veut dire la “France périphérique“
La Chronique de Mickaël Marie
Christophe Guilluy, “La France périphérique. Comment on a sacrifié les classes populaires“
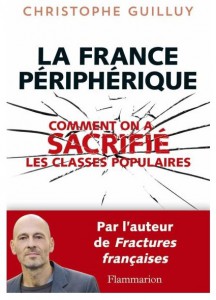 Le dernier livre de Christophe Guilluy frappe fort. Et ça s’entend, ça se voit: en trois semaines, les unes de Marianne et de Libération, des articles dans le Figaro et le Nouvel Observateur, pas mal d’autres en ligne (dont cet excellent article sur Slate.fr). Le livre fait parler, et c’est une bonne nouvelle. Pour en déplorer le manque de rigueur scientifique, pour reprocher à l’auteur de préférer le sens de la formule au souci de la nuance, pour s’inquiéter aussi de ce que ses analyses constatant le chevauchement des clivages sociaux et des clivages ethniques puisse nourrir le concert identitaire qui gangrène le pays. Mais aussi, comme le souligne Laurent Davezies, géographe remarqué pour ses travaux sur les inégalités territoriales, parce que Guilluy “a mis le doigt sur quelque chose“.
Le dernier livre de Christophe Guilluy frappe fort. Et ça s’entend, ça se voit: en trois semaines, les unes de Marianne et de Libération, des articles dans le Figaro et le Nouvel Observateur, pas mal d’autres en ligne (dont cet excellent article sur Slate.fr). Le livre fait parler, et c’est une bonne nouvelle. Pour en déplorer le manque de rigueur scientifique, pour reprocher à l’auteur de préférer le sens de la formule au souci de la nuance, pour s’inquiéter aussi de ce que ses analyses constatant le chevauchement des clivages sociaux et des clivages ethniques puisse nourrir le concert identitaire qui gangrène le pays. Mais aussi, comme le souligne Laurent Davezies, géographe remarqué pour ses travaux sur les inégalités territoriales, parce que Guilluy “a mis le doigt sur quelque chose“.
Ce “quelque chose“, c’est un fait, bouscule. Guilluy, continue d’explorer ce qu’il avait mis au jour dans le déjà brûlant Fractures françaises (2010) : la France, selon lui, est traversée de fractures territoriales aussi profondes qu’incomprises par les élites politiques. Mais ce n’est plus dans les banlieues, espaces depuis plus de trente ans admis comme zones de relégation, que se joue le plus grave et, pour Guilluy, le plus important. La grande vulnérabilité, désormais, se nicherait dans cette “France périphérique“ frappée par la désindustrialisation et le sous-emploi, hors de tout point de contact – à la différence des banlieues – avec les aires métropolitaines insérées dans la mondialisation. La France périphérique, c’est celle qui est à l’écart et ne peut plus même espérer que ruisselle sur elle un peu des richesses créées et accaparées par les métropoles. La France périphérique, celle des petites usines, de la vieille industrie ou de l’agro-alimentaire, celle des classes populaires anciennes, couches sociales formées pendant les Trente glorieuses et fragilisées depuis. La France périphérique, celle des “Petits Blancs“ désormais plus éloignés encore, selon Guilluy, de l’attention de la puissance publique que les populations d’origine immigrée vivant dans les banlieues, alentours immédiats des grandes villes. Cette France là, dit encore Guilluy, meurt sans éclat. Il y a deux France, et il y en a une qui n’intéresse plus personne. On – la gauche et la droite – a délibérément sacrifié les classes populaires, jugées has been et rugueuses, inadaptées au grand vent de la mondialisation et de l’émoi multiculturel. On les a jetés, obligés, vers le Front national.
Le “quelque chose“ sur lequel Guilluy a mis le doigt bouscule, on l’a dit. Dérange et brûle un peu. Dans ses meilleures pages, le constat rappelle la très juste et sensible enquête d’Aymeric Patricot sobrement titrée “Les Petits Blancs“, parue l’an dernier. Un quelque chose qui donne le sentiment du vrai, mais paraît quand même salir les doigts. Un quelque chose auquel on préférerait ne pas trop avoir à toucher. Penser la société et ses contradictions en termes de catégories ethniques, on ne mange pas de ce pain là. Les dominants, les dominés, l’aliénation et l’exploitation, oui, mais distinguer entre elles les victimes de la guerre économique en fonction de leur couleur de peau, non merci. C’est évidemment ce que certains ont pu écrire, traquant avec vigilance les “dérives“ et pointant dans les analyses de Guilluy des traces de “populisme“, ce mot valise qu’on emploie pour disqualifier avant même de s’efforcer d’analyser.
On peut aussi faire autrement, lire autrement ce livre, et en retenir déjà cette phrase : “si l’on n’agit pas sur les raisons qui conduisent à la montée de Marine Le Pen, rien ne sert de crier au loup“. Tout excessif qu’il soit dans certaines de ses analyses – l’homme fait parfois de la géographie à coups de marteau – Christophe Guilluy pointe des faits et des phénomènes qui racontent la montée de la défiance, la sécession progressive d’une part du pays avec sa représentation politique, et concourent à expliquer la massification de l’abstention comme le vote FN. Refuser d’entendre cela, comme il est parfois proposé par ceux qui répugnent à être dérangés dans leurs certitudes, c’est prendre le risque de ne plus pouvoir agir dessus. On ne peut pas changer ce qu’on refuse de comprendre.
On peut dire beaucoup sur ce livre, et lui faire bien des reproches. Reste que, si l’on est sincèrement soucieux à la fois de comprendre les changements qui travaillent la société française et d’agir sur eux, on ne pourra pas faire l’économie d’au moins en débattre. C’est un livre dérangeant, oui. Parfois mal foutu, oui. Mais qu’il faut lire et discuter sérieusement si l’on veut, précisément, conserver une chance d’éviter à notre pays le destin qu’il lui prédit.
“La France périphérique. Comment on a sacrifié les classes populaires“,
Christophe Guilluy,
Flammarion.
18 €
___________________________________________________________________________________________
Dominique Méda, “La mystique de la croissance. Comment s’en libérer“
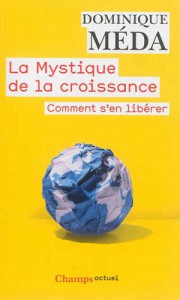 C’est un livre que devraient lire toutes celles et ceux qui ne se satisfont pas de voir le débat public cannibalisé par l’obsession du retour de la croissance. Et se désespèrent de constater que rien, malgré les alertes répétées, ne change vraiment. Pour démystifier la croissance, Dominique Méda, explore les soubassements de nos croyances et les impasses vers lesquelles elles nous entraînent. La maison brûle déjà, n’espérons pas qu’elle ira mieux si la croissance mondiale devait repartir comme hier. La question, désormais, est celle de nos fétiches : sommes-nous capables d’imaginer d’autres manières de mesurer la prospérité ? D’inventer autre chose que l’accroissement de la production matérielle – dont nous savons les risques qu’il nous fait encourir – comme seul horizon économique et social ? Dominique Méda fait le point sur les nombreuses recherches en cours et trace des pistes de méthode bienvenues.
C’est un livre que devraient lire toutes celles et ceux qui ne se satisfont pas de voir le débat public cannibalisé par l’obsession du retour de la croissance. Et se désespèrent de constater que rien, malgré les alertes répétées, ne change vraiment. Pour démystifier la croissance, Dominique Méda, explore les soubassements de nos croyances et les impasses vers lesquelles elles nous entraînent. La maison brûle déjà, n’espérons pas qu’elle ira mieux si la croissance mondiale devait repartir comme hier. La question, désormais, est celle de nos fétiches : sommes-nous capables d’imaginer d’autres manières de mesurer la prospérité ? D’inventer autre chose que l’accroissement de la production matérielle – dont nous savons les risques qu’il nous fait encourir – comme seul horizon économique et social ? Dominique Méda fait le point sur les nombreuses recherches en cours et trace des pistes de méthode bienvenues.
Un point, en particulier, retient l’attention et suscitera, on l’espère, la réflexion : comment construire les coalitions sociales porteuses de ces changements ? “L’accord, écrit Dominique Méda, qui existait au tout début de la crise, en 2008, avait permis la mise en place de plans de relance verts ; des alliances inédites s’étaient nouées entre syndicats et mouvements écologistes : une véritable cause commune avait émergé“. Cette “cause commune“ a été balayée par la violence et l’approfondissement de la crise. Il n’y a probablement pas d’effort plus urgent que de tenter de la retisser. Le livre de Dominique Méda peut y aider grandement, et c’est pour cela aussi qu’il vaut d’être lu.
“La mystique de la croissance. Comment s’en libérer“,
Dominique Méda,
Flammarion,
réédité en poche, collection Champs Actuel.
8 €.
___________________________________________________________________________________________
Thomas Porcher et Frédéric Farah, “TAFTA. L’accord du plus fort“
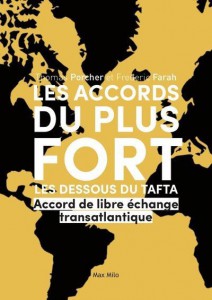 Vous voulez comprendre le projet de grand marché transatlantique, ce traité TAFTA (ou TTIP) dont on commence à parler (beaucoup) dans les réseaux militants et (un peu) dans les “grands médias“ ? Lisez ce livre. Soixante pages, c’est évidemment plus long qu’un tract, mais ça permet de mieux expliquer. Les auteurs s’y attachent, pédagogues et sérieux, et font le tour de ce que pourrait signifier la signature d’un tel accord commercial entre l’Europe et les États-Unis. Abaisser les barrières douanières, “libérer les entraves“ pesant sur la libre circulation des marchandises et des capitaux, sécuriser les multinationales plutôt que les citoyens, voilà l’objet de ce traité, dont le grand gagnant, selon les auteurs, ne sera ni les États-Unis ni l’Europe, mais le capitalisme mondial.
Vous voulez comprendre le projet de grand marché transatlantique, ce traité TAFTA (ou TTIP) dont on commence à parler (beaucoup) dans les réseaux militants et (un peu) dans les “grands médias“ ? Lisez ce livre. Soixante pages, c’est évidemment plus long qu’un tract, mais ça permet de mieux expliquer. Les auteurs s’y attachent, pédagogues et sérieux, et font le tour de ce que pourrait signifier la signature d’un tel accord commercial entre l’Europe et les États-Unis. Abaisser les barrières douanières, “libérer les entraves“ pesant sur la libre circulation des marchandises et des capitaux, sécuriser les multinationales plutôt que les citoyens, voilà l’objet de ce traité, dont le grand gagnant, selon les auteurs, ne sera ni les États-Unis ni l’Europe, mais le capitalisme mondial.
Un chapitre, en particulier, intéressera les écologistes, celui sur la transition énergétique. Signer TAFTA, c’est considérer que les compagnies déjà en place – majors du pétrole en particulier – doivent être protégées de tout aléa, et que c’est à partir de leur point de vue qu’il conviendrait, contre l’intérêt public, de définir les politiques énergétiques. A rebours de cette évidence libérale (socialisation des pertes, privatisation des bénéfices), le livre explique que ce sont bien les puissances publiques qui peuvent engager un avenir énergétique profitable aux sociétés civiles, y compris si elles doivent pour cela s’opposer aux intérêts privés des marchands de pétrole, de gaz ou d’électricité.
De Thomas Porcher, on avait déjà pu apprécier le précis, dense et pédagogue “Mirage du gaz de schiste“. Cet ouvrage là, co-écrit avec Frédéric Farah, est dans la même veine, utile pour penser et pour agir. On s’en veut un peu de livrer la (belle) citation qui clôt le livre, mais comme elle le résume bien, on se permet. Elle est du juriste italien Piero Calamandrei : “Le monde est si beau, il y a tant de choses à voir, dont on peut se réjouir, plutôt que de s’occuper de la politique. La politique n’est pas une chose agréable. Mais la liberté, c’est comme l’air, on en mesure la valeur lorsqu’on s’aperçoit que l’on en manque“. Lutter contre TAFTA, c’est s’occuper des belles choses à voir, celles dont on peut se réjouir. C’est s’occuper de politique, celle qui regarde le bien commun.
“TAFTA. L’accord du plus fort“,
Thomas Porcher et Frédéric Farah,
Éditions Max Milo.
6,90 €