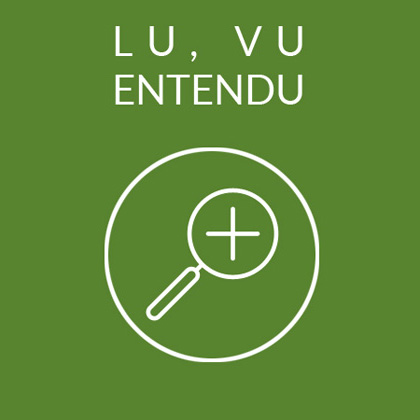Le centre Gabriel-Naudé de l’Ecole nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques (Enssib), organisait les 23 et 24 mars à Paris, à la Bibliothèque nationale de France (BNF) et à la Bibliothèque universitaire des langues et civilisations (Bulac), un colloque intitulé « Où sont les bibliothèques spoliées par les nazis ? ». De nombreux spécialistes venus de toute l’Europe et plus loin sont intervenus pour illustrer les tentatives d’identification et de restitution, une action qui reste un réel chantier en cours.
Le pitch du colloque était : « L’ampleur des spoliations de bibliothèques effectuées par les forces nazies durant la seconde guerre mondiale a été durablement sous-estimée. En France, au moins 5 millions de livres et documents graphiques ont été volés à leurs légitimes propriétaires : ministères, bibliothèques slaves, personnalités des milieux radicaux, socialistes et communistes, francs-maçons. Mais c’est surtout leur lien originaire avec l’antisémitisme nazi qui fait la spécificité première des spoliations nazies. À partir de la mi-1942, accompagnant la mise en place de la solution finale, les saisies touchent des millions de familles juives, dont la culture doit être détruite.
Derrière le rideau de fer, les spoliations nazies sont devenues des « trophées de guerre ». En Europe de l’Ouest, malgré les opérations de restitution mises en œuvre après-guerre, nombre de bibliothèques spoliées n’ont pas, jusqu’à aujourd’hui, été restituées à leurs légitimes propriétaires, lorsqu’ils ont survécu, ou à leurs rares descendants. Où sont les collections qui n’ont pas été restituées ? Quelles furent leurs errances forcées ? Quels usages ont été faits de ces documents ? Quel tableau dresser de cette Europe du livre en partie perdue ? Pourra-t-on, un jour, reconstituer ces bibliothèques ? »
Corinne Bouchoux animait la session 1 intitulée « Perte d’une culture, perte d’une identité. ». En guise d’introduction, elle a rappelé l’engagement de Philippe Sprang, journaliste indépendant, dont les nombreux articles ont permis d’apporter un éclairage sur cette question.
Martine Poulain, conservatrice générale des bibliothèques, chercheuse au Centre Gabriel Naudé (Enssib), intervenait sur le thème « Restituer leurs bibliothèques aux spoliés, un impératif toujours actuel ». Puis Patricia Kennedy Grimsted, chercheuse à l’institut de recherche sur l’Ukraine et associée au Centre Davis des études russes et eurasiennes de l’université d’Harvard et membre honoraire de l’Institut international d’histoire sociale d’Amsterdam, a livré le fruit de ses recherches sur l’histoire des biens culturels déplacés durant la Seconde guerre mondiale et sur les questions de restitutions. Jorn Kreuzer de l’Institut pour l’étude des Juifs allemands a également exposé ses travaux autour de la spoliation des bibliothèques juives situées à proximité des synagogues. Malgré ces témoignages, il existe encore de nombreux pans d’ombre dans l’histoire des collections spoliées.
Pour clôturer cette première session le public a pu assister à une cérémonie de restitution d’un registre d’état civil manuscrit (1751-1771) par la bibliothèque centrale et régionale de Berlin à la commune de Verpel en France. A l’issue du colloque, un représentant de la Bibliothèque centrale et régionale de Berlin a remis officiellement à plusieurs ministères français des ouvrages transférés en Allemagne il y a plus de 70 ans.
Ces deux journées, rythmées par les restitutions, ont permis de donner un signal fort en direction des ayants-droit, des historiens et chercheurs et d’explorer de nombreuses pistes de réflexion.
Pour accéder au programme, c’est ici