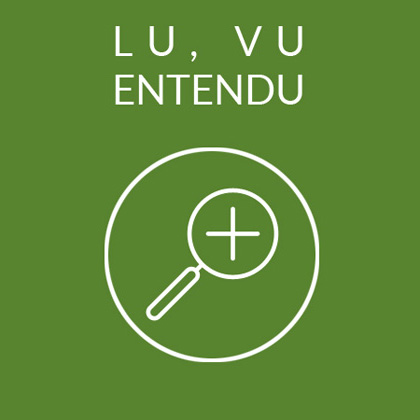À la demande de la Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, le Sénat a débattu, lors de sa séance publique du 22 novembre 2016, des conclusions de son rapport « 2006-2016 : un combat inachevé contre les violences conjugales ».
Les groupes politiques du Sénat ont présenté leur point de vue sur ce sujet, en présence de Mme Laurence ROSSIGNOL, ministre des familles, de l’enfance et des droits des femmes.
Voir la vidéo de la Délégation à l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes.
Corinne Bouchoux est intervenue pour le groupe écologiste:
Mme Corinne Bouchoux. Madame la présidente, madame la présidente de la délégation, madame la ministre… Je pense qu’il faut remercier nos dix collègues de sexe masculin qui nous font l’amitié d’être parmi nous. (Sourires et applaudissements sur de nombreuses travées.)
Alain Gournac. Ah ! Bravo !
Mme Corinne Bouchoux. C’est le Sénat à l’envers ! Cet hémicycle, qui compte 25 % de femmes, est aujourd’hui composé de 80 % de sénatrices… Pourquoi, sur ce sujet qui concerne tout le monde – les auteurs sont à 95 % de sexe masculin et les victimes sont très souvent des femmes –, sont-ce toujours les mêmes qui doivent s’en charger ?
Puisque le Sénat n’examinera pas les crédits de votre ministère cette année, madame la ministre, et que nous ne siégerons pas le 8 mars en raison des élections, je voudrais profiter de ce débat pour vous remercier sincèrement ainsi que la présidente Jouanno pour le travail qui a été mené sur ce dossier. Je persiste à croire que si nous pouvions travailler sur tous les sujets de façon aussi constructive et posée qu’à la délégation aux droits des femmes, la France irait mieux et les débats seraient plus sereins, y compris dans cette assemblée.
Tout ayant été dit dans les trois interventions précédentes – je partage tout à fait les propos de mes collègues – et l’excellent rapport, que j’invite tout le monde à lire, ayant été synthétisé de manière très pertinente, j’insisterai simplement sur deux points.
Premièrement, il n’est pas toujours nécessaire de faire plus de lois. Appliquons les textes qui existent et consacrons-leur des moyens ! C’est, me semble-t-il, une remarque de bon sens.
Deuxièmement, le phénomène des violences conjugales est complexe et systémique. Il se situe sur un continuum de violences faites à un individu, le plus souvent à une femme. C’est pourquoi la lutte contre les violences conjugales commence avec la prime éducation, aussi bien à l’école qu’en famille.
Roland Courteau. Exactement !
Mme Maryvonne Blondin. Absolument !
Mme Corinne Bouchoux. Sans doute suis-je une utopiste – sur certaines travées aujourd’hui clairsemées de cet hémicycle ces idées ne plairont peut-être pas –, mais si nous parvenions à éduquer les enfants dans nos familles avec moins de préjugés, si nous pouvions lutter contre tous les stéréotypes à l’école – je sais que cela est fait –, nous pourrions davantage nous situer dans la prévention que dans la répression et la réparation. Nous savons à quel point les préjugés sont importants dans les dynamiques de violence.
Cela a été dit, les plans de lutte contre les violences conjugales vont dans le bon sens, mais des choses restent à améliorer. À cet égard, un point nous semble particulièrement important : je veux parler de la formation. Je pense bien évidemment à la formation des acteurs du quotidien – les juges, les policiers, les gendarmes, les travailleurs sociaux, les bénévoles des associations, sans lesquelles nous ne pourrions rien faire –, mais aussi à celle de tous les citoyens. Je rappelle que l’article 51 de la loi d’août 2014 vise à délivrer une formation sur les violences à tous les professionnels qui travaillent sur ces questions. L’objectif est de développer la connaissance des dispositifs existants et la capacité à évaluer la vraisemblance du danger. Il est parfois compliqué de ne pas s’immiscer dans la vie privée ; en effet, comment dénoncer sans s’immiscer ? Enfin, il convient de veiller à ne pas mettre la victime en présence de l’auteur.
Sur ce dernier point, des idées contre-productives ont parfois circulé. Pour ma part, je voudrais faire une minute de réclame à mon département. Au tribunal de grande instance d’Angers, un dispositif, dont le coût est très raisonnable, permet, grâce à une double captation vidéo, d’effectuer une confrontation entre l’agresseur et la victime sans les mettre à dix centimètres l’un de l’autre. Certains pourraient penser que c’est un peu gadget. Or pas du tout ! Le garde des sceaux a pu constater sur place la semaine dernière que ce dispositif fonctionne très bien. Il serait important que d’autres départements recourent à cette procédure.
Je profite du temps de parole qu’il me reste pour dire que, si les violences faites aux femmes sont un phénomène très grave, dramatique – il existe une journée symbolique pour le rappeler –, il y a un sujet qui n’est pas sans lien avec cette question : ce sont les violences faites aux enfants. Je pense par exemple aux abus sexuels commis sur des enfants. Dans son numéro de décembre, le mensuel Psychologies Magazine lance un appel à rénover les politiques publiques en matière de prise en charge des enfants victimes d’abus sexuels. C’est une cause aussi importante que celle qui nous réunit aujourd’hui, et je sais que vous y serez très sensibles. (Applaudissements.)
Crédits: Sénat – SK