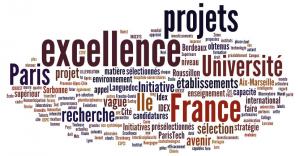Intervention sur le bilan d’application de la loi relative aux libertés et responsabilités des Universités (LRU)
Intervention de Corinne Bouchoux du mardi 11 juin 2013, lors du débat sur le bilan d’application de la Loi du 10 Aout 2007, relative aux libertés et responsabilités des Universités (LRU) .
Corinne Bouchoux : Monsieur le président, madame la ministre, madame, monsieur les rapporteurs, mes chers collègues, plusieurs observations tout à fait pertinentes ont déjà été présentées sur l’application de la loi LRU. Pour ma part, je reviendrai quelques instants sur l’intitulé du rapport de la commission sénatoriale pour le contrôle de l’application des lois : « Le big-bang à l’heure du bilan ». Je vais vous exposer les raisons pour lesquelles nous considérons que le terme « big-bang » était assez prétentieux et que, à l’heure du bilan, on constate surtout un grand flop sur un certain nombre de sujets.
À quoi sert l’université ? Telle est la question essentielle à laquelle nous devons répondre. Selon nous, l’université sert à former des étudiants qui seront en situation de réussite ; ensuite, ceux-ci devront s’insérer dans la société, trouver un emploi et devenir des citoyens éclairés.
La loi LRU, dont il a été rappelé tout à l’heure à quel point elle avait été contestée et incomprise par la communauté universitaire, a-t-elle permis un grand nombre d’avancées ? Quels problèmes restent en suspens ?
Conjuguée à la loi du 18 avril 2006 de programme pour la recherche, dite « loi Goulard », puis aux investissements d’avenir décidés dans le cadre du grand emprunt, la loi LRU était censée, si nous avons bien compris, donner de l’autonomie aux universités afin que celles-ci, grâce à la divine providence d’une nouvelle gouvernance, puissent mettre en place un fonctionnement interne qui modifie soudainement les règles du jeu, produisant à la fois du savoir et de la réussite pédagogique.
Seulement, une lecture attentive du rapport révèle que les déconvenues sont nombreuses ; permettez-moi d’en mettre en lumière les principales.
Tout d’abord, quelle qu’ait été la bonne volonté des présidents des universités, la présidentialisation du système a conduit à la concentration de nombreux pouvoirs entre les mains d’une seule personne, élue de surcroît par un groupe beaucoup plus restreint qu’auparavant. Si l’on peut se réjouir du resserrement des conseils d’administration, qui ressemblaient parfois à des armées mexicaines très difficiles à manier, cette hyper-présidentialisation de la gouvernance nous semble regrettable.
De fait, un certain nombre de membres de la communauté universitaire, parmi les étudiants, les techniciens ou les étudiants, déplorent que le conseil des études et de la vie universitaire et le conseil scientifique ne soient que des chambres d’enregistrement, au lieu d’être les lieux d’un débat contradictoire qui permettrait d’améliorer la gouvernance globale du système.
Ensuite, nous regrettons beaucoup que, à aucun moment, la loi LRU n’ait abordé le vrai problème qui se pose en France : la cohabitation, qu’il faudra bien un jour résoudre, entre des grandes écoles, dont les élèves sont issus de milieux privilégiés et auxquelles on accorde beaucoup de moyens, et les universités, qui accueillent des jeunes de milieux beaucoup plus défavorisés et auxquelles on donne en moyenne deux fois moins – telle est l’implacable vérité des statistiques. Tant que l’on ne s’attelle pas au règlement de ce problème, aucune difficulté de fond ne peut être résolue !
Par ailleurs, l’application de la loi LRU s’est heurtée au problème des moyens financiers et humains. Le logiciel SYMPA, décidément très mal nommé, était destiné à donner un peu plus aux établissements vertueux afin de récompenser la bonne gestion. Toutefois, comme il était extrêmement étroit dans ses paramètres, ne prenait pas du tout en compte les universités sous-dotées et faisait complètement fi de l’historique, ce logiciel s’est révélé contre-productif.
Un autre problème se pose : celui du glissement vieillesse technicité, ou GVT. En effet, on a transféré aux universités la gestion des personnels sans leur donner les moyens de prendre en compte la progression de carrière de ceux-ci. Ce système était inique dès l’origine, puisqu’on transférait une compétence sans transférer les moyens correspondant ; c’était un jeu de dupes, et du reste tout le monde le savait !
On ne peut pas reprocher aux universitaires qui dirigent les établissements d’avoir mal géré, dès lors que l’État se désengageait et ne leur donnait pas les moyens matériels et humains de gérer le volume horaire très important qu’ils devaient assumer, ainsi que les carrières des enseignants. Je le répète : ce problème était inhérent au système ; la loi LRU présentait un défaut de conception à cet égard.
De même, le fait qu’un certain nombre d’universités sous-dotées aient dû embaucher en masse des CDD et, parfois, recourir à des CDI est une conséquence nécessaire de la loi LRU. Il en résulte un système de grande précarité et une situation paradoxale, puisque, après avoir créé des emplois qui répondent à des besoins et qui ont permis dans certaines universités d’améliorer la réussite des étudiants, on se trouve face à un choix budgétaire : financer le soutien aux étudiants ou chauffer les universités entre le vendredi et le mardi. Songez, mes chers collègues, que certains établissements n’ont été chauffés que deux jours dans la semaine ! Je vous le demande : quelle image cela donne-t-il de notre enseignement supérieur à l’étranger ?
L’université, c’est non pas seulement des enseignants et des étudiants, mais aussi des locaux. À propos de cette question immobilière, qui est un serpent de mer, je vous invite à consulter les conclusions très récentes de la Cour des comptes sur la situation des universités.
En raison d’un vice dans la conception même de la loi LRU, on a vu se reproduire le problème qui s’est posé il y a quelques années dans les collectivités territoriales. On a confié aux collectivités les lycées et les collèges, qui étaient très vétustes et remplis d’amiante, en plus d’être des gouffres énergétiques, en demandant à ces collectivités de faire mieux ; or elles ont effectivement fait mieux. Les universités aussi sont tout à fait capables de bien faire, à condition seulement qu’on leur donne les moyens de mener une politique ambitieuse. L’autonomie sans les moyens, c’est un jeu de dupes !
En outre, comme l’a signalé M. Mézard, la loi LRU n’a absolument pas permis de réduire la fracture entre les universités bien dotées et les plus pauvres ; au contraire, au jeu de l’autonomie, le gouffre s’est creusé entre les établissements privilégiés et les moins favorisés.
Enfin, à quelques jours de l’examen du projet de loi relatif à l’enseignement supérieur et à la recherche, nous devons nous poser cette question essentielle : lorsqu’on met des acteurs en situation de stress intense en leur disant qu’ils sont libres, leurs interactions sont-elles automatiquement favorisées, la gouvernance est-elle automatiquement plus efficace et le travail automatiquement meilleur ?
M. Bruno Sido. Normalement, oui !
Mme Corinne Bouchoux. En ce qui nous concerne, nous pensons que l’autonomie sans les moyens, la liberté sans un engagement de l’État permettant d’honorer les promesses faites, ce n’est qu’un marché de dupes !
Telles sont, mes chers collègues, les différentes limites de la loi LRU que nous tenions à souligner. Dans la mesure où son abrogation n’a pas été prévue, nous aurons à cœur, lors de l’examen du projet de loi relatif à l’enseignement supérieur et à la recherche, d’enrichir le texte du Gouvernement, afin que l’université favorise la réussite des étudiants et ne sacrifie pas certains territoires. (Applaudissements sur les travées du groupe écologiste, du groupe socialiste et du groupe CRC, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)