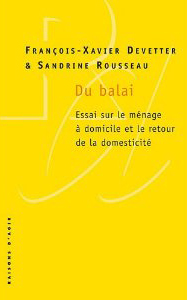A propos de « Du balai – Essai sur le ménage à domicile et le retour de la domesticité »
A propos de « Du balai – Essai sur le ménage à domicile et le retour de la domesticité » de François-Xavier Devetter et Sandrine Rousseau (éditions Raison d’agir-140 pages – 8€). Par Alain Lipietz.
Sans exagérer, ce petit livre est une contribution décisive à l’un des débats centraux de l’après 2012 et du premier quart de ce siècle : les services « d’aide à la personne ».
Un mot sur le qualificatif « petit », qui agace certains auteurs. Je l’ai déjà soutenu à propos des livres d’Eva Sas ou de Guillaume Duval : aujourd’hui faire court est un « plus » pour un essai. Les gros livres, y compris les miens, risquent désormais de ne plus être lus, ou ils seront prétendument lus et en diagonal. Faire « court » est donc un qualificatif d’excellence, tout en justifiant des choix : tout n’y est pas traité. Ce n’esgt pas un « traité ». C’est d’ailleurs l’esprit de plusieurs collections militantes, telles que Raison d’Agir, ou les Repères et autres « Sur le vif » des éditions La Découverte.
Cette excellence, qui est brièveté, n’exclut pas la densité. Et ce livre d’un sociologue et d’une économiste est bourré de citations d’enquêtes, de chiffres. Les raisonnements s’appuient à la fois sur les témoignages et les statistiques.
De quoi s’agit-il ici ? De l’escroquerie qui consiste à réunir sous le concept « aide à la personne » deux choses très différentes. D’une part l’aide nécessaire aux personnes dépendantes à domicile (et qui souhaitent très légitimement rester à leur domicile). Et d’autre part, le service d’entretien su domicile rendu à des ménages qui ne souhaitent pas s’en occuper et ont les moyens de s’en dispenser.
Il ne s’agit évidemment pas de critiquer ces dern iers. Si on a la chance d’avoir un peu d’argent, on le dépense en objet, en voyages ou en temps libéré, et le recours à du personnel de ménage est un moyen de gagner du temps libre.
Mais, nous expliquent les auteurs, nous ne racontons pas que cela fait avancer la libération des femmes. C’est un moyen de faire avancer la libération du temps des femmes des classes moyennes, qui se substituent à des mesures plus radicales telle que la réduction de travail salarié pour les deux sexes et une meilleure répartition du travail domestique entre les deux sexes.
Ce n’est pas non plus une libération pour les femmes réduites à accepter le « sale boulot » chez les autres. Certes, c’est mieux que l’ancienne domesticité, car le salariat préserve au moins l’autonomie et l’intimité de la personne de ménage (par rapport aux domestiques logés et parfois mariés ou « troussés », comme dirait JFK, par leurs maîtres). Mais, si le salaire horaire parait dans la plupart des cas correct pour un travail que « tout le monde peut faire », il représente une telle charge physique et souvent une telle dangerosité chimique, il est si éclaté entre de multiples sites, que cela représente nécessairement un temps assez partiel et donc un salaire mensuel le plus bas. C’est un travail qu’une femme prend quand elle ne peut pas faire autre chose.
C’est enfin un travail sans aucune perspective de promotion professionnelle : fondé sur un savoir-faire que la plupart des femmes sont censées avoir développé chez elles, il n’apporte aucune qualification supplémentaire et ne permet aucune carrière.
Tout autre est le travail de l’aide à domicile pour une personne dépendante. Travail qui peut être gratifiant, de plus en plus qualifié, avec même la possibilité d’un parcours professionnel et une stabilisation dans les institutions.
Mais le problème n’est pas seulement de distinguer « aide » réelle à une personne dépendante et travail d’entretien des choses au bénéfice d’une personne (le care et le clean comme les opposent les auteurs). Il s’agit d’examiner la justification de ses deux types de métiers, l’un et l’autre fortement subventionnés par l’Etat. Aides publiques du même ordre de grandeur (3 à 4 milliards par an), ce qui représente un niveau de subventionnement par emploi créé qui n’est pas mince. Mais dans le cas du care, il s’agit d’une politique sociale, voire médico-sociale. Dans le second cas il s’agit ni plus ni moins que d’une subvention au budget, à la norme de consommation des classes moyennes. Tout milliard consacré au second cas est un milliard non disponible pour la premier. Or le vieillissement de la population, avec la croissance des situations de semi dépendance voire de dépendance, appellera inexorablement à une croissance du care « véritable ».
Et ne disons pas non plus que les subventions au clean favorisent sa démocratisation. Un raisonnement brillamment mené par les auteurs, appuyé sur les entretiens et sur un petit calcul budgétaire, montre que pour qu’une femme de la classe moyenne ait intérêt à louer les services d’une femme de ménage plutôt qu’à le faire elle-même, il faut que la différence entre son propre salaire et celui de la femme de ménage soit déjà assez considérable. Donc, pour que le recours à une femme de ménage soit acceptable par un ménage à bas salaire, il faudrait que la subvention publique soit énorme… Bref, le retour de la domesticité est la conséquence typique du retour au libéralisme économique, seul le retour des inégalités sociales à des niveaux proches du XIXe siècle l’a rendu possible, et son subventionnement par l’Etat est une politique de droite, typique du sarkozysme qui prend aux pauvres pour donner aux riches.
Organisationnellement parlant, alors que le care a tendance à s’organiser selon la formule du tiers secteur (c’est à dire des structures associatives ou coopératives pouvant offrir une aide « sans compter son temps » parce que largement subventionnée), le clean, le service de ménage à domicile peut facilement être pris en charge par des auto-entrepreneuses, des grandes entreprises, voire des entreprises semi-publiques comme la Poste. Les aides publiques n’étant pas soumises à des conditions de revenus ni de nécessité médicale (dépendance), la concurrence ouverte s’y livre… à coup de bas salaires. Car il s’agit toujours d’un marché, pour les clientes (ou célibataires masculins) des classes moyennes et supérieures.
La démonstration est implacable et confirme en tous points ce que, face à la première décennie de mise en place du modèle libéral-productiviste, les économistes progressistes et féministes avaient déjà pronostiqué (voir mon livre de 1996, La société en sablier, ou un résumé prospectif pour le cas des femmes, présenté au collectif MAGE->http://lipietz.net/spip.php?article322].)
Ce livre est donc, je le répète, une contribution majeure à l’analyse et à la prospective des politiques publiques face aux problèmes du travail salarié das le domicile d’autrui. Je me permettrais simplement quelques critiques et interrogations.
D’abord, ce livre (parce qu’il est « petit »…) n’aborde pas en détail la question du travail domestique comme tel comme le fit Jean-Claude Kaufmann. Il tient pour acquis qu’une part peu gratifiante et n’entraînant aucun lien social, le ménage, peut être externalisé. Et en effet, le livre ne traite que du ménage, activité qui s’effectue d’autant mieux que les clients ne sont pas dans leur logement et que, bref, ça n’a strictement rien à voir avec un « service à la personne » !
Mais quid… de la cuisine ? C’est à dire quid de l’activité consistant à préparer ce qu’il y a de plus précieux pour quelqu’un d’autre et à le lui servir ? Ici, la distinction entre le care et le clean devient extrêmement floue. Or cette différence provoque bien des malentendus. Ainsi, ma mère, 90 ans, a effectivement besoin et d’une aide à domicile, et d’une femme de ménage. Elle ne comprend pas que la personne « qui vient l’aider » (à faire sa toilette par exemple) n’est pas là pour lui faire son ménage et en particulier les vitres ou son argenterie. Mais l’une et l’autre acceptent très bien qu’elle puisse lui préparer son repas et lui faire la conversation pendant le repas.
Ce qui nous amène à une seconde interrogation, plus subtile : le statut des rapports personnels femmes-femmes dans la domesticité. Dans toute la première partie du livre, ce lien personnel entre la maîtresse de maison et la domestique est considéré comme négatif, et la médiation du lien de dépendance salarié par une entreprise (prestatrice) qui loue le travail de la domestique est considérée comme une modernisation, d’une certaine façon une libération. Mais quand les auteurs en viennent à constater les dégâts de la pression de concurrence sur la salariée, ils se souviennent qu’il existe dans la domesticité classique (et même dans le cas de la « fidèle » femme de ménage en auto-entreprise) des liens de confiance et de réciprocité qui n’existent pas dans le salariat pur : aide et conseil aux enfants, et même aide aux accidents de la vie de femme (tels que viol, grossesse indésirée…). Ce point (le « plus de chaleur humaine ») n’est pas traité, et d’ailleurs ce « petit » livre ne traite pas du care comme tel, ni du care organisé en tiers secteur associatif avec dialogue entre des associations d’usager-e-s et associations d’aide à domicile, tel que prôné dans le livre de Brigitte Croff, Elles.
Détail plus intriguant : la critique du RSA, qui « dessine les contours d’une société foncièrement inégalitaire, productiviste et rétrograde » (p.34). Intriguant parce que Sandrine Rousseau est membre du bureau exécutif d’Europe-Ecologie-Les-Verts et conseillère régionale verte chargée de l’enseignement et de la recherche pour la Région Nord-Pas-de-Calais. Or ce parti a approuvé la transformation du RMI en RSA.
La critique du RSA n’est pas explicitée avant la page 49 : les entreprises de service à domicile (c’est-à-dire louant des femmes de ménage) recherchent des femmes touchant le RSA parce que ce « matelas » leur permet de vivre avec un supplément de revenu plus bas. Les spécialistes de débats sur le revenu universel reconnaîtront la vieille critique dans d’André Gorz sur le « revenu universel insuffisant » (voir mon livre La société en sablier).
Le principe du revenu universel est en effet que toute personne touche un revenu de base même sans travailler. Si elle travaille, elle reçoit en plus une rémunération. Et au-delà d’une certaine rémunération, elle paie un impôt qui lui permet de financer…. le revenu universel de tout le monde. Objection de Gorz : si le revenu de base est faible, c’est à dire qu’il ne permet pas vivre avec une activité purement bénévole, pour ses proches ou la société, sur ce seul revenu de base, alors on est obligé d’accepter un boulot salarié supplémentaire, et le revenu universel se transforme en subvention de fait pour l’employeur : plus il est élevé moins, on a besoin de verser un salaire supplémentaire.
Le gouvernement Rocard (1988) avait crée le RMI, Revenu Minimum d’Insertion qui prenait la forme d’une subvention dont étaient soustraits les revenus que les bénéficiaires pouvaient toucher par ailleurs grâce à leur travail. Lorsque j’étais au Conseil d’analyse économique de Lionel Jospin, nous avions poussé des études assez effarantes sur l’effet pervers de ce mécanisme : un chômeur au RMI qui trouvait un travail à temps partiel se voyait supprimer son RMI et d’autres avantages fiscaux, et se trouvait donc taxé à plus de 100% ! Nous proposions donc d’introduire une sorte de « soufflet de transition », c’est à dire le droit de conserver une partie de son RMI en plus des premiers euros gagnés par son travail. C’est la logique que Hirsch a réussi à imposer avec le RSA. La travailleuse à bas salaire touchant le RSA est donc dans la situation même que Gorz définit comme revenu universel insuffisant.
Mais faut-il pour autant dénoncer sans nuance le RSA ? Que veulent exactement les auteurs ? Supprimer complètement le RMI de base, c’est-à-dire l’allocation garantissant un revenu plancher même pour les personnes totalement inactives ? Supprimer la possibilité, que représente le RSA, d’additionner à ce RMI à un revenu du travail ? Augmenter le niveau du RMI (ou « RSA de base ») alors qu’un sondage effrayant montre que la grande majorité de la population française, toutes familles politiques confondues, sauf les électeurs verts, approuve aujourd’hui les déclarations de Wauquiez sur les bénéficiaires du RSA, traités de fainéants voire de « cancers » de la société ? Cette augmentation ne supprimerait d’ailleurs pas l’avantage que trouveraient les employeurs à privilégier des femmes de ménages touchant le RSA…
La question de l’aide aux pauvres et très bas revenus est donc aujourd’hui de la dynamite, que nos excellents auteurs me semblent traiter sans précaution.
On ne pourra cependant que les rejoindre totalement dans leur conclusion (« Que faire ? »). Le Care, c’est à dire l’aide véritable aux personnes dépendantes est le seul, par son utilité sociale, à justifier une aide massive de l’Etat. Ce care doit être organisé sous la forme d’un tiers secteur (économie sociale et solidaire) et ce tiers secteur doit offrir lui-même un revenu correct et une professionnalisation valorisante. L’’espace du Clean peut être occupé par des auto-entrepreneurs ou des entreprises privées. Ses salariés doivent être protégés et leur travail revalorisé. Des pistes existent, telle que l’intervention d’équipes de plusieurs personnes apportant leur matériel performant.