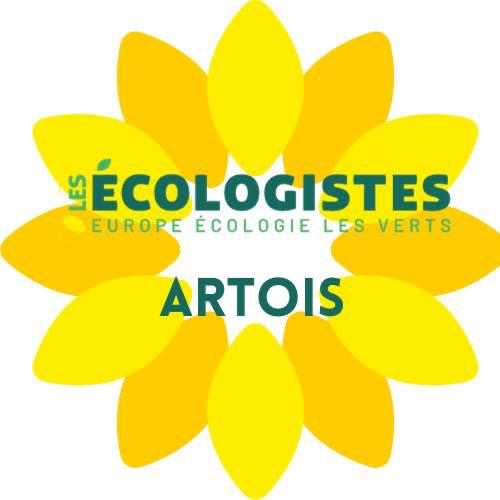Nous traversons actuellement un processus essentiel de l’écologie politique en France, qui semble rencontrer enfin son public, son électorat. Je ne veux pas nécessairement m’emballer car deux scrutins consécutifs et a priori favorables, sur deux années, ne font pas la durée. Surtout si le second marque un tassement – peut-être dû à une approche d’élections locales finalement nationale sans réelle réflexion inter-régionale.
Néanmoins, il faut reconnaître le succès d’Europe écologie (sinon à quoi bon vouloir contribuer au processus en cours, hein?). La question qui se pose à nous est simple : comment faire en sorte de pérenniser ce succès?
1. Un succès « hors norme ».
Ma conviction est que cela tient à un ensemble de conditions porteuses : le rassemblement de personnalités d’horizons divers – et notamment pas « marqués » politiquement -, l’aspiration des sympathisants par le recours au principe du signataire, enfin une crédibilité reposant à la fois sur la relative nouveauté de « l’offre électorale » et le souci de traiter avant tout les questions écologiques.
Il faut avoir conscience que partie de ce succès tient donc à l’aspect nébuleux de la forme politique d’Europe écologie. Il est de fait légitime de s’interroger sur une évolution qui pourrait dissiper ce flou dans une forme claire : un nouveau parti au fonctionnement classique. Il m’est assez difficile de le dire car j’ai adhéré notamment sur le slogan « La politique autrement », mais au fond, dans l’opinion, les Verts sont désormais considérés comme les autres de ce point de vue.
2. Une nébulosité aux effets inattendus.
Cet aspect nébuleux a posé et pose encore problème : quelle légitimité pour celles et ceux qui n’ont pas une investiture quelqu’elle soit d’un parti? Certaines et certains sont installés dans le champ politique avec des préoccupations écolos depuis longtemps et voient débarquer ou revenir des personnalités propulsés par la dynamique Europe écologie, pensant peut-être que cette dernière leur dérobe ce qui leur revenait de droit (c’est humain).
Il faut tout de même prendre le temps, devant l’inquiétude manifestée ici par certains Verts, d’examiner les bénéfices tirés par les différentes parties prenantes d’Europe écologie dans les dernières élections. Les Verts ont tout simplement raflé la mise en Seine-et-Marne, avec quatre élus sur cinq aux Régionales. On peut rappeler la proportion entre signataires Europe écologie et adhérents Verts : 300 contre 130 environ. Quand bien même la plupart de ces derniers sont signataires, ils demeurent minoritaires.
Paradoxe local (ou effet per-Verts ;°)) : le ressort de la dynamique que constitue l’apport individuel de chaque signataire profite essentiellement à l’appareil sur laquelle elle s’appuie – sans doute parce qu’il est constitué, précisément, en structure. Il faut bien prendre conscience de cela pour évaluer le champ de nos possibles dans la structuration du rassemblement des écologistes.
3. Valeurs des engagements et traduction électorale : le respect nécessaire du principe un(e) signataire = une voix.
Peut-on émettre une réserve sur le fait qu’il s’agisse de signataires, qui n’ont pas payé d’adhésion – ce qui peut constituer une barrière, et donc une distinction significative entre signataires EE et adhérents Verts?
C’est à mon sens un des ressorts du succès d’Europe écologie que d’avoir produit une mobilisation sur la base de signatures. Si donc elle est significative, en effet, c’est en faveur d’un militantisme ne reposant pas nécessairement sur l’adhésion. Il faudra bien un jour considérer que l’on puisse s’investir dans la politique en fonction de ses disponibilités et moyens et, entre autres, sans nécessairement payer un écot. C’est du moins une interrogation que le processus actuel pose très nettement.
Tout inquiets que ces Verts puissent être, il ne faut pas oublier précisément cette dynamique EE, et ses résultats. Il importe donc de considérer que dans le processus actuel qui vise au rassemblement des écologistes dans une formation nécessairement politique, quelqu’en soient les contours, nous venons chacune et chacun avec pour seule légitimité notre désir d’y contribuer, par nos idées, nos expériences, nos débats, nos échanges. C’est avant tout non pas en se crispant sur le passé mais en se tournant vers l’avenir que celui-ci pourra nous sourire, et consacrer l’imprégnation écologique de la politique.
Quelque soit la forme qui en sortira, il faut souhaiter que cette horizontalité soit le plus possible préservée, effective, et qu’elle soit le cadre d’une circulation des idées fécondant notre parole, notre action et notre rapport aux autres et au monde. Dans la mesure où l’échelon national le rend quasi-impraticable, cela pourrait conduire à un fonctionnement réellement fédéraliste de l’écologie politique sur la base de la géographie régionale, accordant à chaque entité une réelle autonomie.
Sylvain Kerspern, militant Vert de Melun (77)