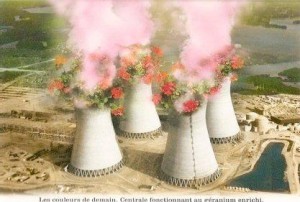Réponse au questionnaire du collectif Sortir Du Nucléaire 21
En décembre 2013, lors du déraillement du train transportant des déchets radioactifs, EELV a rappelé son opposition à ce type de transport à travers les « zones urbaines denses » et les « gares très fréquentées », et la nécessité de prendre des mesures pour interdire ces passages réguliers. Le cycle du nucléaire relève d’une gestion centralisée. Bien que les collectivités locales soient concernées par ces transports, elles n’ont d’une part pas de compétences directes pour agir, celle-ci relevant des services déconcentrés de l’Etat et d’autre part elles souffrent quasiment au même titre que la population d’un manque d’information. Il faut sortir de cette désinformation pour des raisons de transparence, une des base du fonctionnement démocratique. En attendant la résolution au problème des déchets soit enfin trouvée et que les autorités de l’Etat mettent fin à cette filière à haut risque, une solution transitoire est envisageable et ce de façon immédiate : l’entreposage des déchets à proximité des installations nucléaires.
Chaque année en France, 900 000 colis de matières radioactives sont transportés dont 16 % sont pour l’industrie et la recherche nucléaire, chiffres régulièrement mis en avant pour minimiser le facteur risque de l’acheminement des déchets radioactifs par voie ferrée. Or, les résultats du rapport sur la dangerosité du transport des déchets radioactifs de la CRIIRAD de 1998 sont éclairants. Le laboratoire a mesuré, à 50 mètres d’un wagon transportant du combustible irradié, un flux de radiation gamma nettement supérieur à la normale. Le débit de dose gamma neutrons était plus de 500 fois supérieur au niveau naturel, à un mètre du wagon. Comme le rappelle régulièrement la CRIIRAD, la réglementation autorise la circulation, en des lieux accessibles au public, de wagons dont le niveau de radiation au contact peut être si importante, qu’en seulement 30 minutes de présence, un individu peut recevoir la dose maximale annuelle admissible pour le public. En cas d’accident, les matières peuvent se disperser dans l’environnement, bien au-delà des axes de circulation où l’accident s’est produit. Nous savons pertinemment que la pollution dépasse les frontière. Elle est donc l’affaire de tous, aussi bien des collectivités que des habitants. C’est bien le caractère mobile des transports de matières radioactives ( + de 180 000 km/an par voie ferrée) qui génère un risque d’incident ou d’accident nucléaire dispersé sur l’ensemble du territoire français, et qui classe le transport des matières radioactives dans la catégorie des transports de matières dangereuses ( « arrêté TMD » mai 2009).
Malgré cet arrêté qui exclut au passage les activités de transport nucléaire militaire, et les articles 2 et 19 de la loi TSN (2006) qui précisent que la population a le droit d’être informée des risques liés aux activités nucléaires et de leurs effets, (« toute personne a le droit, dans les conditions définies par la présente loi et les décrets pris pour son application, d’être informée sur les risques liés aux activités nucléaires et leur impact sur la santé et la sécurité des personnes ainsi que sur l’environnement, et sur les rejets d’effluents des installations »), le manque de transparence et de moyens mis en place pour informer les populations alors qu’elles sont exposées aux risques nucléaires est évident. Les informations disponibles dans les documents destinés à informer la population ne sont pas parfaites (ex : le Dossier Départemental des Risques Majeurs). Et ce sans doute à cause des réglementations sur le secret.
Notre premier engagement est de mener des actions de prévention et de protection sur le risque « TDM », et d’agir sur les documents d’information locaux tels que le Document d’ Information Communal Risques Majeurs et le Plan Communal de Sauvegarde (juin 2011). Nous réviserons ces documents afin d’y inclure le risque « TMD » relatif aux transports de matières radioactives par voie ferrée. En conformité avec les objectifs de ces documents, cet élargissement permettra d’assurer l’information préventive et la protection de la population au niveau communal, de recenser les moyens disponibles, de déterminer (en fonction des risques connus) les mesures de sauvegarde et de protection des personnes, de fixer l’organisation nécessaire à la diffusion de l’alerte et des consignes de sécurité, de définir les mesures d’accompagnement et de soutien à la population.
Cette modification témoigne de notre volonté à satisfaire la sécurité et la santé de la population car Dijon, comme Drancy, est en zone à risque. La commune est couverte par un Plan Particulier d’Intervention (PPI) en raison du site de la Raffinerie du Midi, classé site Seveso.
Parallèlement, une action conjointe entre la commune et les associations de protection de l’environnement qui jouent un rôle dans la transmission d’information peut porter sur une révision du DDRM. Le DDRM qui recense les risques majeurs présents dans le département, ainsi que les communes concernées pour chacun d’entre eux, peut également être révisé sur le même principe que les PCS et le DICRIM pour garantir la transparence et la diffusion de l’information au plus grand nombre.
Enfin même si le Maire, en tant qu’autorité de police administrative, doit anticiper les mesures afin de garantir la sécurité et la salubrité publique, il n’a aucune compétence en matière de transports ferroviaires. Ainsi prendre un arrêté l’interdisant, c’est prendre le risque d’une annulation de la mesure par le Tribunal Administratif comme ce fût le cas pour la Mairie Bègles en 2004. Cet arrêté aurait certes une valeur symbolique, mais vu les risques environnementaux et sanitaires auxquels est exposée la population dijonnaise et bien au-delà, notre priorité et nos objectifs doivent porter avant tout sur des travaux réalisables qui aboutiront à un résultat concret en matière de transparence et de protection. Nous serons néanmoins attentif à la jurisprudence en ce domaine, et à l’évolution de la législation afin de voir si des marges de manœuvre se dégagent.
Par ailleurs, suite au voeu adopté par le conseil municipal du 17 novembre 2011, la Ville sollicitera régulièrement le Préfet quant aux retours d’information demandés.